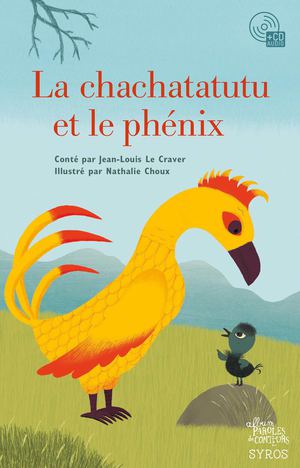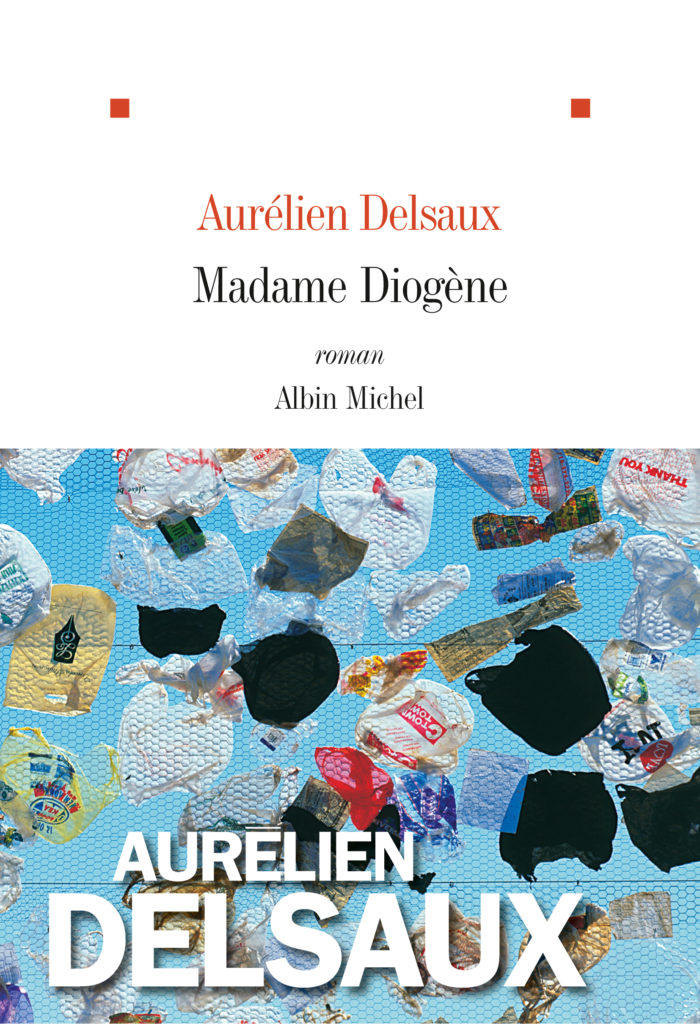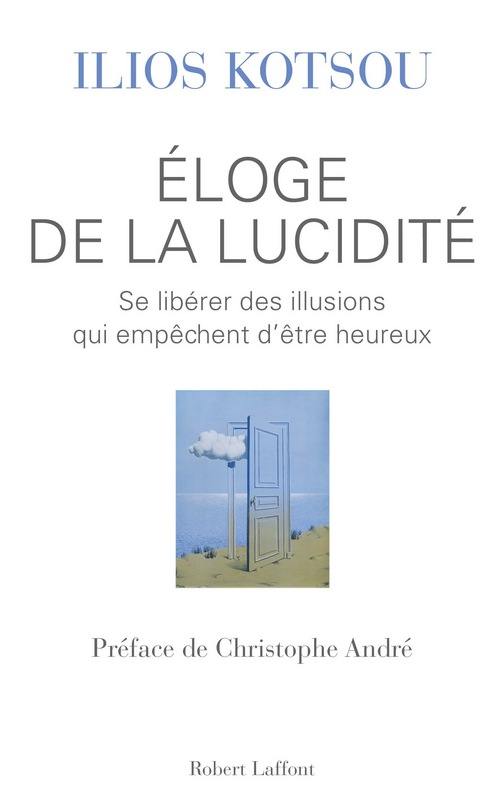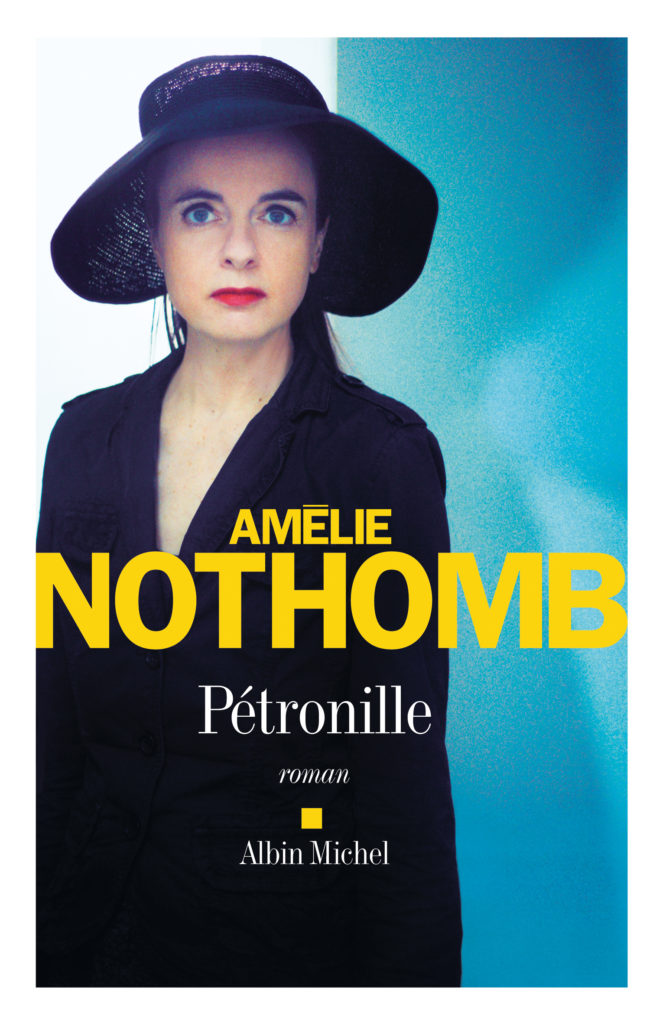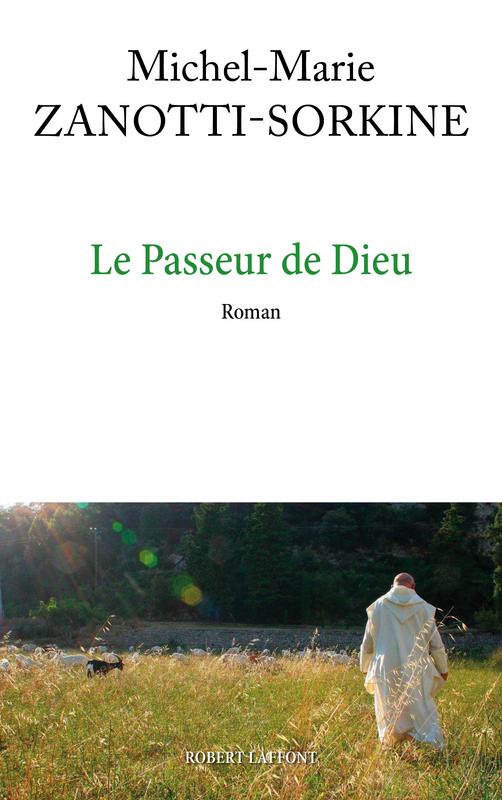Ecrit par Geoffrey Lachassagne,
Publié aux éditions Aux Forges de Vulcain – collection Littérature,
Format 13 x 20 cm, 258 pages.
(Résumé personnel)
Dépourvu d’intrigue, Et je me suis caché est tel un papillon qui se pose sur l’épaule de deux jeunes garçons puis les observe et les écoute, impuissant.
« Et puis c’est venu d’un coup, sous la douche. Au début, j’ai cru que c’était parce que j’avais pas mangé. J’avais comme un volcan qui me gargouillait dedans. Et envie de chialer mais ça restait coincé. Je sentais plus l’eau chaude, rien, j’étais roulé en boule au fond de la baignoire et c’était comme si le creux de mon estomac m’aspirait tout entier, comme si une idée de rien du tout se mettait à bouffer tout ce qui l’entourait, et au lieu de rester petite et à l’intérieur, devenait plus grande que moi. Et ça a pas manqué : au bout d’un moment j’ai senti que. Que je me retournais. Comme un gant. Ça me brûlait de partout alors finalement j’ai hurlé. »
L’un, surnommé Titi, est un adolescent de 14 ans abandonné à son mal-être et à ses débordements de colère contre un monde qui l’abandonne – sa mère est partie sans se retourner, son père a lâché prise et s’est lui aussi enfui, larguant ainsi Titi et ses frères qui furent recueillis par leurs grand-parents âgés et malades, dont l’un décéda lentement dans la douleur, ne laissant que son épouse fatiguée à leurs côtés. Meurtri dans sa tendre enfance, Titi grandit dans l’incompréhension. Incapable de s’aider et n’ayant personne pour l’épauler, il est victime de sa solitude et ne comprend pas les émotions violentes qui l’assaillent. Malheureux, il ne parvient pas à surmonter son chagrin ni à accepter l’amertume de son existence : alors il déraille et endure de terribles crises de nerfs, comme autant de tortures psychiques et corporelles car c’est tout son être qui se débat et extériorise une détresse asphyxiante. Constamment incompris, accusé, jugé, moqué et ignoré, Titi ne trouve aucun réconfort chez ses proches, ni même auprès de sa grand-mère qui ne connaît que la violence et la religion pour remettre son petit dans le droit chemin. Mélancolique, il s’isole et décide de partir, loin, très loin, croyant ainsi laisser derrière lui ses tourments.
« (…) y avait ce gamin qui tchatchait en me matant et les autres autour qui se pliaient en deux en se tenant le ventre en s’arrachant la gorge de rire, et moi j’ai regardé bien droit celui qui faisait des blagues sur ma pomme et je l’ai reconnu : Jojo, un blagueur qu’a de ces blagues qui font rires les vieux, et Collabo, j’ai pensé. J’entendais les hrmm hrmm des vieux qui savaient plus trop quoi dire, je sentais que ça venait, et enfin c’est venu : je suis allé droit vers le gamin et sa tête de mal réveillé ses épis plein la tignasse son front balafré ses sourcils comme des grosses limaces noires sur ses yeux étonnés qui te prennent pour un con ce gros nez rond ces joues molles qu’on a envie de claquer ces babines luisantes qui continuaient de ricaner devant moi planté là face à lui et BAM. »
L’autre, Jérémie, est un petit bout d’homme de tout juste 7 ans dont l’existence est encore plus infâme que celle de son grand frère. S’il a lui aussi vécut la fugue parentale, il n’était alors qu’un bébé et ne semble pas avoir été réellement affecté par le drame familial ; cependant, les répercutions de cette tragédie sur son existence sont terribles, car il n’a vécu qu’aux côtés de sa grand-mère, martyr de Yahweh engoncée dans ses textes religieux et qui l’obligea, dès son plus jeune âge, à l’accompagner dans ses virées de porte-à-porte afin de prêcher la bonne parole et peut-être convaincre le voisinage de rejoindre Yahweh. Soir après soir, pour l’endormir, cette grand-mère aveuglée par sa foi lit à son petit-fils des passages du grand Livre – l’Ancien Testament – et c’est ainsi que Jérémie grandit au travers d’une croyance imposée et artificielle. Pour affronter l’existence, il n’a de cesse de s’appuyer sur les textes bibliques et ne comprend la signification des mots et des événements qu’au travers de cette foi abrutissante. Les années passent et l’enfant semble abêti par cette spiritualité déraisonnée : c’est un gamin étrange qui bénit les meubles, les plantes et les êtres avec le sang de son steak haché et dont les pensées prennent la forme et la formulation de prières, la plupart des phrases se ponctuant d’un solennel « Ainsi », terme bien trop grave pour l’esprit d’un petit garçon fragile qui n’a de cesse de prier pour que tous meurent à condition que son grand-frère ne meurt pas, lui, rocher au milieu de l’océan. Qu’il ne l’abandonne pas.
« Et le gamin s’est assis entre nous. On a plus trop rien dit. A cause que Jérémie était là, à nous coller, peut-être. En tous cas pour Moïse. Moi c’était plutôt – ce que je sentais c’était plutôt – un gros coup de poing dans le ventre. Et mon souffle coupé.
– Je sais pas quoi faire.
Ben moi non plus. A part chialer.
– Joue.
– Je sais pas à quoi.
– Au foot.
– J’ai pas de ballon.
J’étais déprimé. Plus que ça, même. J’essayais d’imaginer les mêmes plans qu’avant, mais sans les copains ; la même chose, mais en triste.
– Y en a pas, de ballon. Ici.
– Ben tu fais comme si.
Et tout ce que je voyais, tu vas te marrer, c’était moi, barbu, en loques, à vivre tout seul comme un con sur une île. Titi Crusoë. Et son esclave Jérémie.
– C’est vraiment nul.
Je sentais que j’en voulais au monde entier. Aurore. Moïse. Même le petit. Comme si c’était eux qui m’avaient mis ces idées dans le ciboulot, que j’avais foncé tête baissée dans le vide et qu’au dernier moment, quand c’était trop tard pour faire marche arrière, je me rendais compte qu’ils avaient pas bougé et qu’ils me regardaient de loin, en se foutant de ma gueule. »
Il y a également ce troisième frère, Jules, parti sans se retourner des années auparavant et dont ses frères, surtout Titi, attendent fébrilement le retour. Ce retour, tout à fait symbolique, signifierait la fin d’une existence misérable et difficile, le terme d’une solitude détestable, l’oubli de toutes souffrances pour un nouveau départ aux côtés d’un être solide et fort, vers Paris. Titi vit dans ce rêve quotidien, dans cet espoir fou de voir revenir le fantôme de ce frère idolâtré – le seul, peut-être, qui est en mesure de le comprendre et de l’aider. Tout le roman se construit autour de cette attente maladive et interminable ; ainsi, il n’y a pas de réelle intrigue à ce roman et à peine une histoire, le récit d’une espérance infinie exprimée au travers d’un texte taillé à même une sombre réalité, profondément dramatique et désolante. On plonge brutalement dans l’univers de ces deux frangins mal aimés, qui se noient dans leur détresse et souffrent de leur insignifiance. On plonge, et c’est douloureux.
« Des fois, j’ai l’impression d’être né dans un rêve, et d’en sortir jamais. Imagine la fenêtre d’un car, où on verrait à la fois le paysage qui défile, le reflet des passagers, et les bonhommes qu’ils ont dessinés dans la buée – tu vois ? Je suis la vitre. Et en même temps je la regarde, à moitié halluciné par tout ce cinéma, à moitié endormi par le ronronnement du bus, avec toujours cette impression de capter ce qui se passe que des siècles trop tard. »
Le roman est polyphonique, accordant par alternance la narration à Titi puis à Jérémie. Ceux-ci ne s’expriment pas pour le lecteur, mais s’adressent à leurs grand-frères respectifs, Titi dirigeant ses pensées vers Jules et Jérémie s’adressant à Titi, au travers d’un monologue spirituel incessant, dans un flot de pensées désaxées, brouillonnes, désordonnées, toutes bouillantes et écumantes de rage, de violence, de grossièreté et d’une excessive tristesse. Dès lors, soulignons l’intelligence et la dextérité scripturale de Geoffrey Lachassagne qui est parvenu à donner, grâce à des mots savamment malaxés, manipulés et judicieusement agencés, une voix imaginaire tout à fait singulière à chacun de ses personnages.
Pour insuffler la vie au personnage de Titi, l’écrivain s’est efforcé de transcrire un franc-parler adolescent qui ne ressemble à aucun autre : nulle caricature et nulle facilité, nous sommes à des lieux du langage stéréotypé du petit voyou banlieusard ; Titi s’exprime dans un style qui lui est personnel, se nourrissant d’une insolente familiarité, d’une vulgarité convenue, d’un je-m’en-foutisme affûté, d’expressions branchées et de termes désuets probablement empruntés aux sexagénaires de son village, et à cet enchevêtrement de mots s’ajoute un charme campagnard involontaire ainsi qu’une poésie bucolique inconsciente, enfantée par de trop nombreuses rêveries sous l’astre brûlant. Ce langage indéfinissable, association originale de l’argot d’une jeunesse crapuleuse et du patois d’une Corrèze poussiéreuse, se révèle sublime de spontanéité et de vraisemblance. Déconcertante douceur et brusque verdeur s’entremêlent dans des ébats incongrus, dévoilant un texte d’une beauté insoupçonnée, piquante et aigre comme du vinaigre car les mots portent en eux les souffrances du jeune garçon, ainsi que ses faiblesses.
« Ca dure qu’une minute, je sais, le temps de passer la porte du Royaume, mais chaque fois j’ai quand même l’impression que c’est parti pour la vie, à se faire comprimer, bousculer, la vue bouchée par leurs dos tout voûtés, la gorge remplie de cette odeur de vieux, avec cette fatigue à mes basques, et puis aussi Jérémie, et sa nuque bouffée d’eczéma, perdu au milieu d’une forêt de guiboles, ses doigts accrochés à l’ourlet de mon bermuda, ses yeux aux miens. C’est tout ça que je sens. Et qui comprendrais, si je me mettais à chialer là, tout bêlant et morveux, brassé au milieu du troupeau de Yahweh ? »
Donner voix au personnage de Jérémie fut très certainement un exercice davantage difficile car celui-ci est plus jeune, plus naïf et plus étourdi que son frère et ne dispose pas d’un raisonnement assez mature pour appréhender avec intelligence les événements qui l’entourent ; de plus, ses pensées juvéniles se devaient d’être le miroir d’un esprit embourbé dans une religion qui n’a eu de cesse de l’amollir pour mieux le manipuler. Artisan de son texte, Geoffrey Lachassagne a pétri les mots avec ardeur, les a patiemment manipulés et assouplis pour mieux les plier à se volonté, jusqu’à oser des associations inaccoutumées, surprenantes de créativité et de justesse dans la transcription de ces pensées enfantines troublantes. Au moyen d’une syntaxe affolante, les chants bibliques sont transformés et transposés à une réalité déformée par une foi lancinante. Jérémie filtre son existence au travers de l’Ancien Testament et son imaginaire de gosse, bridé par ses croyances bigotes, illusionne des chasses religieuses fanatiques, projette des épiphanies dans le brouillard campagnard et recrée la Création par la gestuelle et la voix. Tout son petit être est envahi par cette ferveur religieuse qui l’empêche de rire, de s’amuser ou d’inventer les jeux universels de l’enfance et seul son émerveillement parvient à s’exprimer, au moyen de prières inventées et d’une absurde multitude de termes religieux.
Le roman s’amuse de cette conception singulière de la religion et s’accapare de sa symbolique pour l’intégrer à son récit. Si je ne peux me permettre une véritable comparaison entre ce roman et la religion car je n’ai pas de connaissances assez solides en la matière, il est toutefois évident que le roman se construit en empruntant des symboles essentiels à l’Ancien Testament, proposant ainsi un jeu de pistes intelligent aux lecteurs.
Malgré la justesse des mots employés et l’impressionnante créativité dont a fait preuve l’auteur afin de doter ses personnages d’une personnalité forte et unique, je ne suis pas parvenue à apprécier véritablement ce roman. Je lui reconnais pourtant de nombreuses qualités et le conseillerais sans hésitation ! Hélas, je dois avouer ne pas aimer les histoires tragiques : je crois en effet que la vie cause déjà de trop nombreuses souffrances à l’être humain, aussi je préfère m’évader dans la joie, l’amour et la franche camaraderie. Or, les enfants que l’on découvre dans ce roman sont tous empreints d’une profonde tristesse et même de nobles sentiments tels que l’Amour ou l’Amitié sont teintés d’amertume, comme si le bonheur leur était à jamais inaccessible. Ainsi, pas un seul instant je n’ai imaginé ces enfants sourire ! Par contre, c’est sans difficulté que je les imaginais ravagés par la souffrance, repliés sur eux-mêmes, penchés mélancoliquement au-dessus d’une canette de bière et avalant, d’un rire cynique, des médicaments dangereux pour s’exploser la cervelle dans des délires à trois milles mètres au-dessus du sol. L’univers dans lequel évoluent ces pauvres gosses est si sombre et désespéré que j’éprouvais du chagrin à chaque fois que je reprenais ma lecture. J’étais particulièrement peinée par Jérémie, ce tout petit si fragile et si seul, abandonné à des fantasmes religieux dont il ne saisit pas le sens, mais qu’il essaie malgré tout de respecter car sa grand-mère les lui a inculqués et qu’il sait ne pas avoir le choix. Ces enfants sont perdus dans un brouillard d’incertitudes, à mi-chemin entre le Bien et le Mal et, négligeant la valeur de leur vie, ils enchaînent les bêtises et s’approchent toujours plus près du danger. Et je me suis caché saisit l’effroyable réalité d’une jeunesse tourmentée, sacrifiée à des jeux funestes dont la mort est si proche qu’on la sent inéluctable. Les dernières lignes du roman furent terribles, car j’eus le sentiment que tout allait se réécrire, boucle infernale d’idiotie humaine qui se transmet de génération en génération.
« Les autres choses il les met un peu partout dans l’île. Pour décorer. Un peu n’importe quoi. Des pancartes, des sacs plastique, des bidons crevés, de toutes les couleurs. Et puis des tableaux. De ceux qu’on ramasse dans la rue, avec les encombrants. Certains il les accroche aux arbres ; ses préférés il les cache. Dans la cabane il a mis un saint Christophe, avec son grand bâton et son auréole, son petit Jésus qui lui brille sur le dos. Au fond des bosquets il en a planqué d’autres, des petits tableaux maronnasses, déglingués, où on voit le bas d’un tronc, et la bordure d’un feuillage, au-dessus d’un sentier où se promène une dame, tout seule, avec une robe plein de dentelles, un chapeau et un parapluie. Ca fait comme une fenêtre dans la forêt, sur une autre forêt. Et quand il regarde à travers, il peut même se croire embusqué dans les sous-bois, prêt à sauter sur la comtesse. Ca le fait bien triper. Le plus grand tableau c’est un puzzle, en fait, d’un bateau pris dans la tempête. Et c’est tellement vilolent, comme tempête, que le bateau c’est plus qu’une tache floue. Mais il comprend bien, lui, et il les sent, comme s’il était pris dedans, la mer en vrac, le vent, la trouille. Vu que ça le faisait rire, il l’a accroché au même tronc que la barque. »
Mes sincères remerciements Aux Forges de Vulcain ainsi qu’à la charmante équipe de Libfly pour leur confiance renouvelée, ainsi que pour le plaisir que me procurent ces découvertes dans le cadre de l’opération « Un éditeur se livre ».