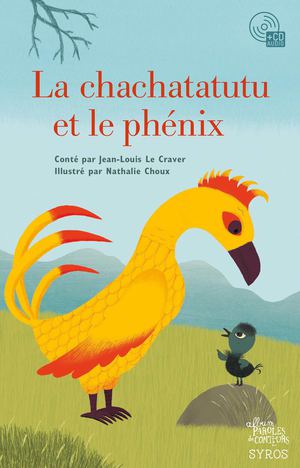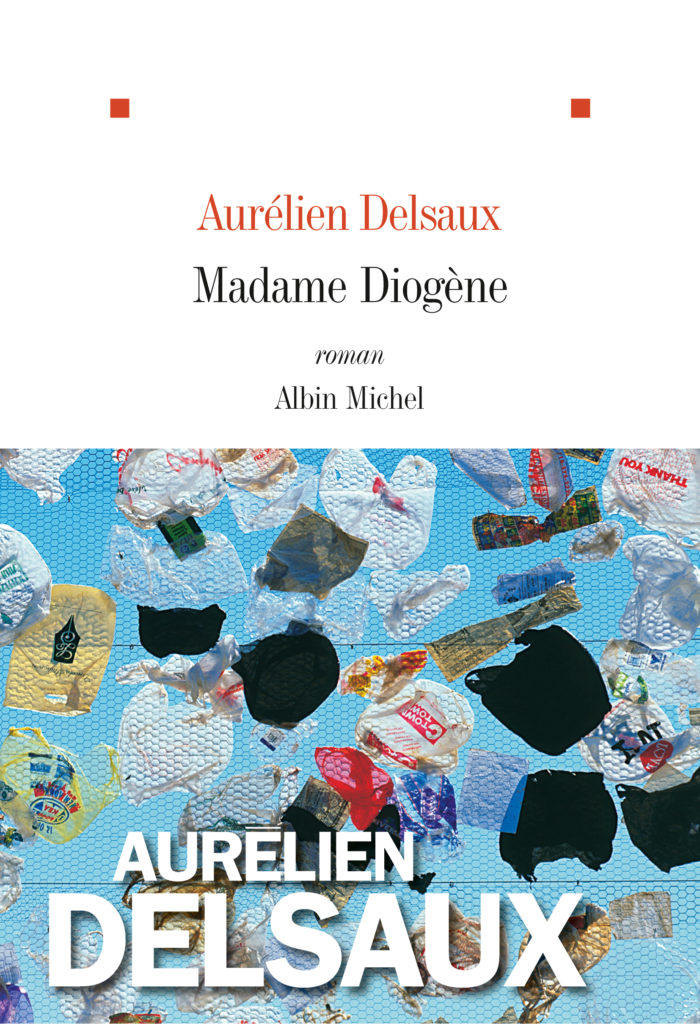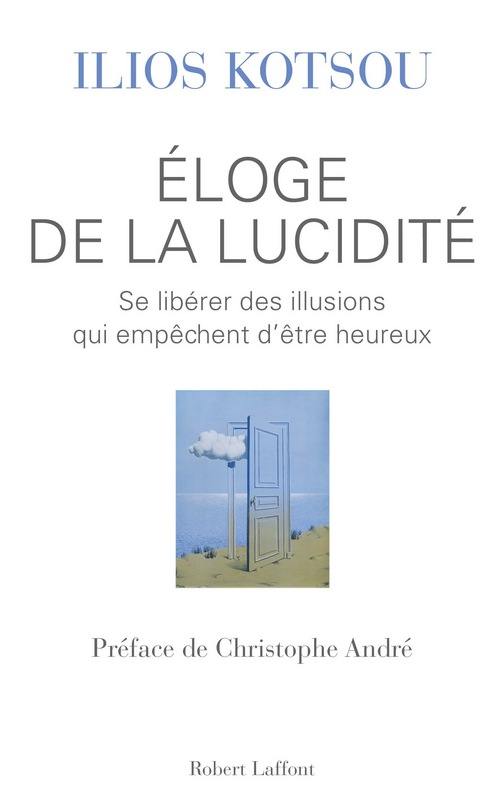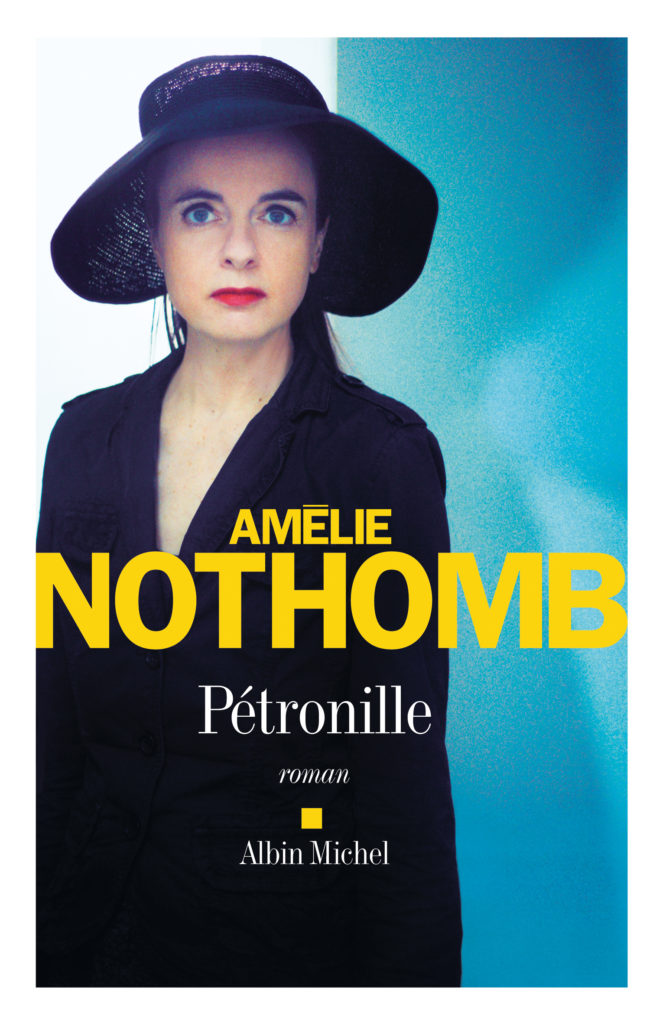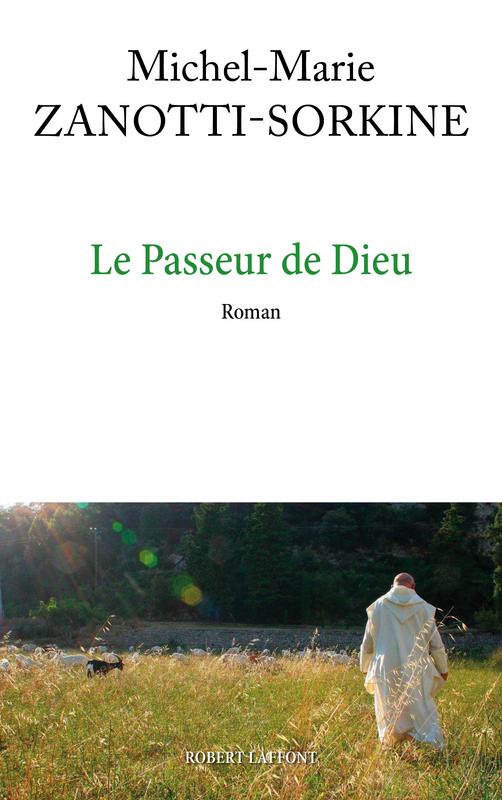Ecrit par Agota Kristof,
Parution le 06/03/2014, éditions Points,
192 pages, 6€30.
(Résumé personnel)
La Grande Ville subit la guerre, ses bombardements, ses morts, ses privations extrêmes. Une mère, désespérée, amène ses deux jeunes garçons dans la Petite Ville – un coin de campagne reculé, encore isolé des massacres et de la famine – où demeure sa propre mère, surnommée la Sorcière.
Cette vieille femme aux propos cruels l’accueille avec mépris, enfant dégoûtant qui depuis dix ans n’a donné aucune nouvelle à sa propre mère. Pourquoi devrait-elle recueillir ces deux mioches inconnus, les nourrir par des temps si difficiles, elle, vieille femme dédaignée de tous ?
Finalement contrainte d’accepter chez elle ses petits enfants, cette grand-mère n’en garde pas moins les pieds sur terre : s’ils veulent manger et dormir au chaud, ces gamins devront l’aider et travailler à la ferme. Il y a le jardin à cultiver, les bêtes à traire et à soigner, le bois à couper, etc. Les deux jumeaux, âgés d’une dizaine d’années, acceptent d’aider leur grand-mère et de participer sans rechigner à ces travaux fatiguants, récoltant malgré tout insultes, baffes et autres violences.
Refusant de pleurer et de subir une honte supplémentaire, les enfants décident de s’adonner à des exercices d’endurcissement. Ils se frappent violemment, s’insultent férocement, apprennent à rester des heures sans bouger et affrontent volontairement le froid et la faim jusqu’à ne plus rien ressentir,.
Inventée pour qu’ils survivent là où ils devaient mourir, cette éducation brutale et sauvage aura-t-elle une limite ?
Le grand cahier n’est pas une première parution chez Points, mais une nouvelle publication à l’occasion de l’adaption au cinéma de ce célèbre roman d’Agota Kristof, premier opus d’une trilogie traduite dans plus de vingt pays. La nouvelle couverture de ce roman poche est donc inspirée du film réalisé en 2013 par Janos Szasz, avec au premier plan les acteurs Andras et Laszlo Gyémant.
On pourrait croire l’écriture de ce roman aisée, tant la plume d’Agota Kristof est fluide et accessible, qu’il s’agisse du vocabulaire employé ou de la construction des phrases. En réalité, sous cette apparente simplicité, Agota Kristof s’est adonnée à un exercice extrêmement difficile : celui de donner la parole à deux enfants abandonnés à la souffrance, narrateurs d’un monde qui explose de violence, sans toutefois leur permettre de se plaindre ou d’atteindre la sensibilité du lecteur par la facilité d’un registre pathétique.
Le secret de cette narration aboutie réside dans sa construction talentueuse et inventive. Les pages offertes au lecteur sont issues d’un cahier de papier dans lequel les jumeaux recopient au propre leurs écrits les plus réussis, fruits d’un exercice de composition qu’ils s’imposent régulièrement afin d’entretenir leur éducation. Outre une orthographe et une syntaxe parfaites, les jumeaux s’imposent une consigne simple : ne retranscrire que la réalité objective de leur vie.
« Il est interdit d’écrire : « La Petite Ville est belle », car la Petite Ville peut être belle pour nous et laide pour quelqu’un d’autre. De même, si nous écrivons : « L’ordonnance est gentil », cela n’est pas une vérité, parce que l’ordonnance est peut-être capable de méchancetés que nous ignorons. Nous écrirons donc simplement : « L’ordonnance nous donne des couvertures. » »
Ainsi dépourvue de sentiments et de nuances personnelles, la réalité est abrupte, violente à lire.
Les narrateurs, figés dans cet exercice de style, semblent vidés de leur humanité, enfants privés de leur âme. La plume, concise et froide, invite le lecteur à comprendre par lui-même les événements, offrant à chacun la liberté d’interpréter les événements selon ses propres convictions.
« Dieu tout-puissant, bénissez ces enfants. Quel que soit leur crime, pardonnez-leur. Brebis égarées dans un monde abominable, eux-mêmes victimes de notre époque pervertie, ils ne savent pas ce qu’ils font. Je vous implore de sauver leur âme d’enfant, de la purifier de votre infinie bonté et dans votre miséricorde. Amen. »
La puissance de cette plume permet au Grand cahier, court roman d’environ 160 pages, d’atteindre profondément le lecteur qui se heurte à cette barbarie aussi inattendue qu’effrayante.
Il y a bien sûr cette cruauté incroyable d’une guerre comme tant d’autres, qui usent les Hommes, creusent des tombes dans les deux camps et amène avec elle la famine, la maladie et la misère ; il y a encore la brutalité de cette grand-mère au cœur dur, marquée par une existence de labeur et qui projette sur ses petits enfants toute la souffrance d’une vie d’injustices et de solitude ; mais surtout, c’est une profonde noirceur qui étreint le lecteur à la lecture de ce texte, le sentiment de rencontrer des êtres humains dénaturés, abandonnés à une violence animale ainsi qu’à une monstrueuse perversité.
Toutefois, Le grand cahier n’est pas un drame, ni même une tragédie. La beauté de ce roman réside dans l’espoir, insoupçonné et invisible, qui se déploie au fil des pages jusqu’à s’imposer au lecteur. Face à un monde qui se brise et à cette violence omniprésente, les deux enfants vont trouver en eux l’énergie de vivre et, puisant dans leurs instincts de survie, ils parviendront à restaurer l’amour, la compassion et la fraternité dans les cœurs désolés des Hommes.
Ainsi, Le grand cahier est un roman qui meurtri le lecteur par sa monstruosité et son réalisme, cependant ce texte est surtout une magnifique ode à la vie et à cette incroyable force qui conduit les hommes à survivre au-delà de la souffrance et du mal. Une relecture poignante d’un texte qui ne vieillit pas.